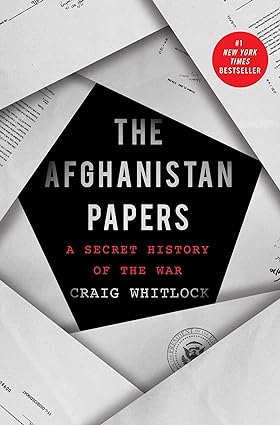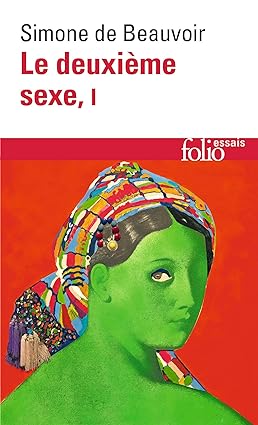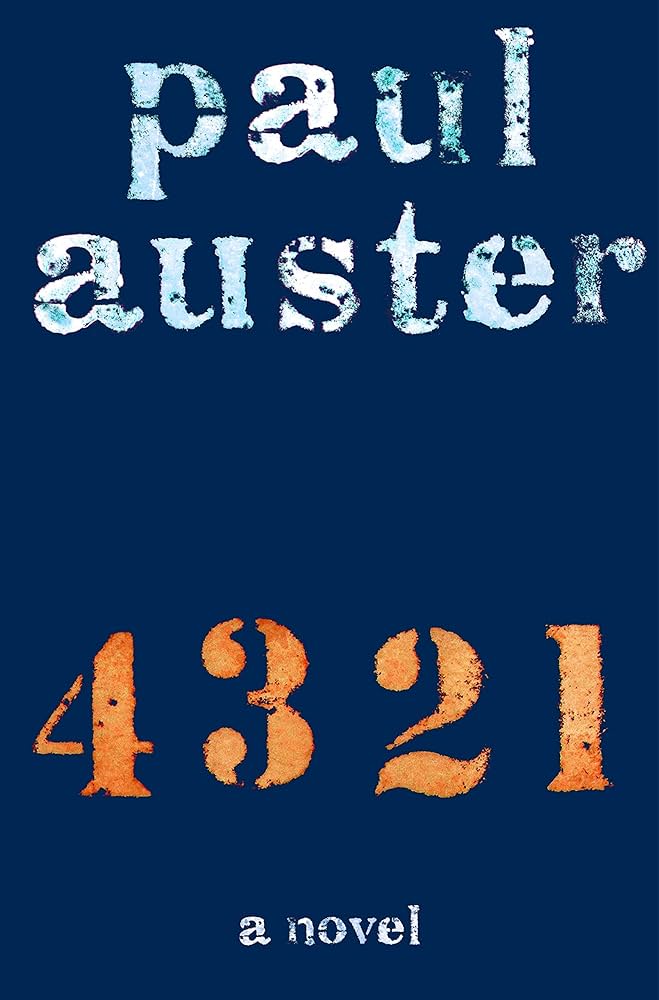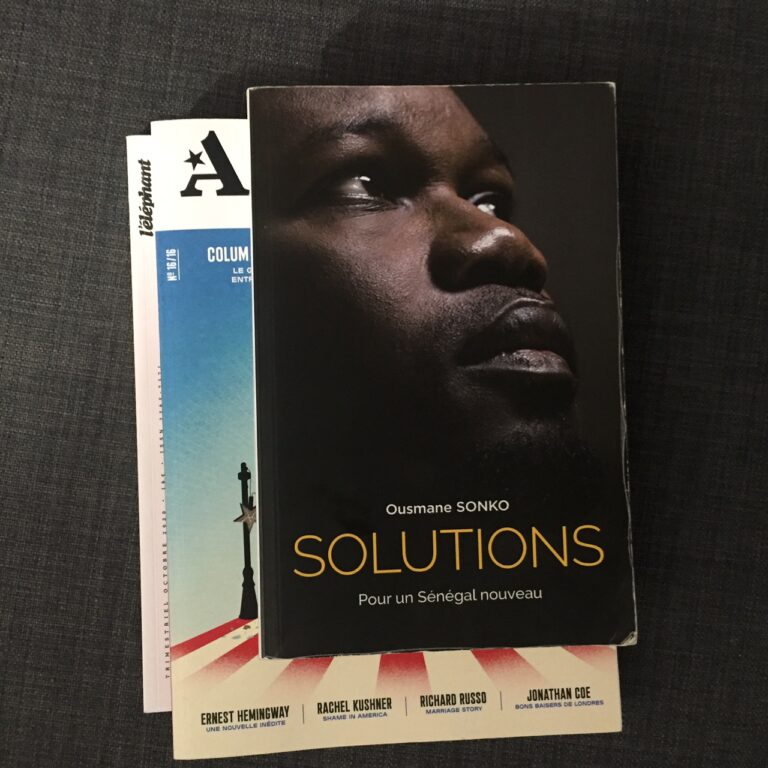Corinne Mencé-Caster, Sorbonne Université
Aya Nakamura, chanteuse franco-malienne à l’aura internationale – elle est l’artiste francophone la plus écoutée au monde –, a été la cible de propos racistes de la part de membres de l’extrême droite, suscitant l’ouverture d’une enquête par le parquet de Paris il y a deux jours.
Cette polémique enfle depuis quelques semaines après une déclaration d’Emmanuel Macron concernant la participation de la chanteuse plusieurs fois primée (dont les Victoires de la musique 2024) à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques où elle interpréterait une chanson d’Édith Piaf.
Cette hypothèse a suscité des réactions de la droite et de l’extrême droite, surtout du parti « Reconquête » et d’un groupuscule d’ultradroite « Les Natifs » qui a déployé une banderole : « Y’a pas moyen Aya, ici c’est Paris, pas le marché de Bamako », faisant référence au refrain de sa chanson phare, « Djadja ».
Un sondage réalisé le 10 mars par Winimax RTL révèle que 63 % des Français seraient opposés à l’idée que la chanteuse puisse interpréter Édith Piaf lors de la cérémonie d’ouverture des JO. Les arguments avancés sont les suivants : les Français n’aiment pas ses chansons (73 %) ; elle ne représente pas la musique française (73 %), et encore moins la jeunesse (60 %). D’autres Français déplacent la polémique sur le terrain linguistique ; c’est le cas du député RN du Nord, Sébastien Chenu qui considère qu’Aya Nakamura ne valorise pas la langue française ou de Marion Maréchal qui déclare qu’elle « ne chante pas en français. Ce n’est ni notre langue ni notre culture. »
Pourtant, le premier titre de la chanteuse, « Djadja », sorti en avril 2018, est devenu le « tube de l’été » en traversant les frontières belges, suisses, autrichiennes, allemandes, etc.
La chanson « Djadja », 2018, a cumulé 951 millions de vues sur YouTube.
Aux Pays-Bas, « Djadja » a pris la tête des ventes, ce qui était une première depuis 1961 où Édith Piaf avait réussi cet exploit avec « Je ne regrette rien ». Le clip de « Djadja » a cumulé 951 millions de vues sur YouTube. Depuis, la chanteuse a atteint plus de 9 millions d’auditeurs par mois et est l’artiste française la plus écoutée sur Spotify.
Pourquoi Nakamura ne peut donc pas, selon certains, « représenter la France » aux JO ? Maltraiterait-elle à ce point la langue française ?
La langue est identitaire
On sait comme la langue est identitaire. Si la France s’enorgueillit de sa francophonie – en témoigne l’inauguration en octobre 2023 de la Cité internationale de la langue française –, elle se réjouit de ce que ce concept instaure une barrière imaginaire entre le français du dehors – « exotique »- et le français du dedans – assimilé à la langue de Molière.
En ce sens, Aya Nakamura aurait toute latitude pour chanter en français à Bamako, mais le faire à Paris, dans une cérémonie qui engage l’image de la France, devient pour certains, une hérésie.
Les textes d’Aya Nakamura sont en effet parsemés de mots issus d’autres contextes linguistiques. On pense ainsi à des termes bambara (« djadja ») ou de l’argot ivoirien (« tchouffer »), mais aussi le verlan à partir de mots français (« tit-pe ») ou anglais (« de-spi » pour « speed ») ou encore quand elle a recourt à des expressions argotiques très contemporaines (« bails », « seum », « afficher quelqu’un », « c pas mon délire », « genre »). Elle utilise aussi des structures qui tordent la syntaxe (« donne-moi douceur » ; « il me voulait cadeau »). Or ces usages s’inscrivent dans une dynamique linguistique qui ne lui est pas spécifique.
Comme tous les poètes, écrivains et chanteurs, elle « invente » une « outre-langue », c’est-à-dire une langue neuve pour réveiller la langue commune. Le pseudonyme « Piaf » (petit oiseau) d’Édith Gassion vient aussi de l’argot et on sait que la chanteuse populaire, comme bien d’autres (France Gall) n’a pas boudé son plaisir de couper ou mixer les mots (« chand » < « marchand » ; « cré » < sacré ; cézigues < ces zigues) ni de jouer sur les consonances et rythmes (« padam padam »).
[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]
« Daronne », argot du XVIIIᵉ siècle
Partout, à côté d’une langue académique, il existe des parlers populaires créatifs, fondés sur des néologismes lexicaux ou sémantiques et divers jeux de langage. Le sens d’un mot comme « daronne » qui, dans le parler des jeunes, signifie « la mère » n’a pas été inventé dans les cités. Au XVIIIe siècle, il existait déjà. Au XIXe siècle, il a le sens de « patronne de bar », avant d’être repris par le milieu prolétarien du XXe siècle pour désigner la mère.
On retrouve, par ailleurs, dans les textes de la chanteuse, des mots du créole ou du français antillais (« boug » ; « bail » qui vient de « bagay » > « bahay »> « bail », en créole : « chose ») ; « dachine », « parler sur quelqu’un »), des mots anglais, espagnols, etc. La musique – le rap en particulier – est un puissant brasseur de langues et de mots d’ici et d’ailleurs.
Beyonce, Feat Jay-Z, « déja vu ».
La langue française est fécondée par les mots venus des terres qu’elle a colonisées, mais aussi par ceux de l’anglais et de l’espagnol « globalisés ». Elle colonise aussi les mots des chansons d’ailleurs : en témoigne le titre « Deja vu » de plusieurs chansons différentes (celles de Post Malone, Justin Bieber, Olivia Rodrigo, Beyoncé, Shakira), écoutées par plusieurs millions d’auditeurs dans le monde.
« Y à R »
Les réseaux sociaux ont bouleversé les pratiques linguistiques par le boom des formes abrégées. Dans « Djadja », Aya Nakamura recourt à « Y à R » pour « il n’y a rien » mais aussi des formes telles que « déter » pour « déterminé » ; « À c’qui paraît » ou « askip » : à ce qu’il paraît).
Elle invente parfois son propre langage (« pookie », « tu dead ça ») avec une cohérence d’ensemble, tout en reflétant des usages bien implantés en France, et pas seulement dans les cités.
Ainsi, « Tu dead ça » renvoie à « tuer quelque chose » qui, en argot, signifie « assurer ». Le verbe « dead », perçu comme plus expressif, est mis pour « tuer ».
S’insèrent aussi des archaïsmes de la France continentale qui sont des mots encore vivaces dans la francophonie : « catin » (‘prostituée’), « palabre » (très utilisé dans le français de l’Afrique subsaharienne), « louper le coche », etc. Cette façon de tordre les mots, de mêler des idiomes différents, de jouer avec les sons n’est pas propre à Aya Nakamura.
Jacques Dutronc, « Merde in France », 1984 (INA).
On pense ainsi à Jacques Dutronc avec « Merde in France », Serge Gainsbourg, ou encore Plastic Bertrand avec « Sentimentale moi » : « donne-moi amour émoi… donne-moi amour et moi… t’es branchée transistor », « t’es branché eskimo ».
Un déni d’universalité ?
Pour rappel, la vitalité de la langue française est due en grande partie aux parlers populaires et à l’argot. Sans cette créativité continue, le français perdrait en vitalité et ne serait plus cette langue de tous les continents qui l’ont fécondé.
La mauvaise foi ou méconnaissance de « Reconquête » et leurs semblables est flagrante. Or, ce sont les mêmes qui quémandent des bulletins de vote au moment des urnes en « outre-mer » et qui ont la nostalgie de la colonisation triomphante.
Le français féconde les autres langues et est fécondé en retour. Aya Nakamura ne chante pas moins en français que les autres, sauf qu’elle n’a peut-être pas la « bonne couleur », et se voit d’emblée assignée au monde de la cité. Que se cache-t-il donc derrière ce rejet, entre racisme et classisme ?
Face à ces réactions jugées « racistes » par Aya Nakamura elle-même (« Raciste mais pas sourd » a répondu le lendemain la chanteuse sur X, et aussi par nombre de personnalités, il faut voir la subsistance de représentations de l’imaginaire colonial selon lesquelles un « Noir » n’a pas accès à l’universel.
Comme nombre de « non Blancs », il se trouve enfermé dans la seule représentation de soi et des gens de sa catégorie, avec tous les clichés associés, dignes du pitch du film An American Fiction, récemment primé aux Oscars.
Bande-annonce de An American Fiction de Cord Jefferson.
La publicité l’illustre bien : au « Noir » sont associés les « objets » noirs ou marron (café, chocolat), c’est-à-dire ce à quoi on l’assimile (une couleur) ou ce à quoi il est réduit (la banane, la fête, le sexe), mais jamais ce qui est perçu comme neutre ou valorisant : un Noir au volant d’une Porsche par exemple.
Franchir la ligne de couleur ?
C’est comme si la « couleur » du « Noir » le prédéterminait à ne pas pouvoir « représenter » l’humanité. Il ne peut, selon certains, représenter tous les êtres humains, et encore moins, les « Blancs ». Ce n’est pas par hasard que, dans la langue, l’expression « gens de couleur », d’origine coloniale, renvoie au « préjugé de couleur » qui délimite une ligne de « couleur » entre les « Blancs » et les « non Blancs ».
La couleur devient un privilège qui conditionne le pouvoir ou non de représenter l’Humain dans son entier, droit refusé auxdits « gens de couleur ». C’est pourquoi une chanteuse comme Aya Nakamura peut se voir dénier le droit de représenter la France, et non pas Edith Piaf qui, malgré ses origines kabyles, a franchi la ligne de couleur.
Pour être « Blanc », point besoin d’être né « Blanc », il faut juste être perçu comme tel, de même que, naguère, pour franchir la ligne du « préjugé de noblesse », point n’était besoin d’être né noble, il suffisait d’être anobli.
Le « préjugé de couleur » reste tenace et les mêmes causes ne créent pas les mêmes effets : Piaf jouant avec le français est une icône, Aya Nakamura faisant de même « ne parle pas français ». L’égérie mondiale de L’Oréal ne peut pas représenter la France, de même que l’équipe de France de football de 2022 ne le pouvait pas non plus, selon certains. Craint-on que le « cocorico » ne soit plus l’apanage du seul coq gaulois ?
Corinne Mencé-Caster, Professeure de linguistique hispanique et romane, Sorbonne Université
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.