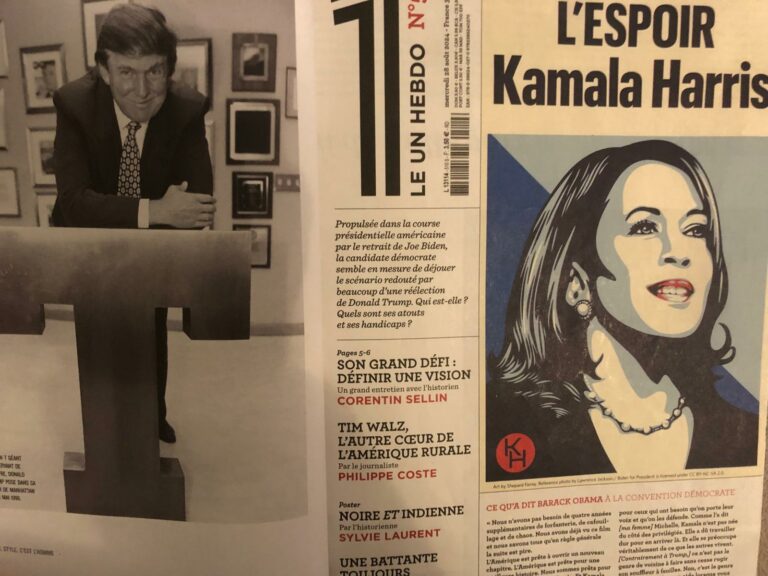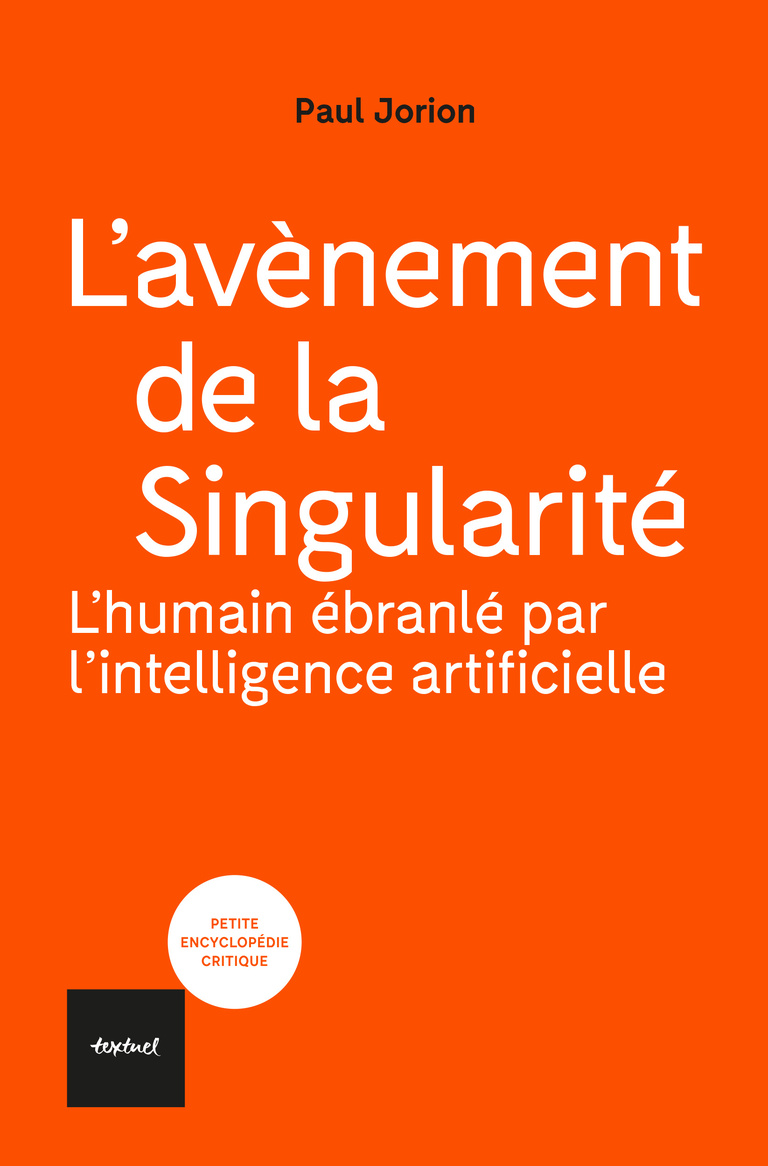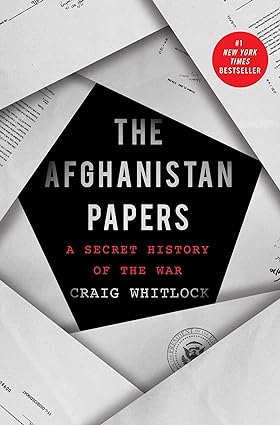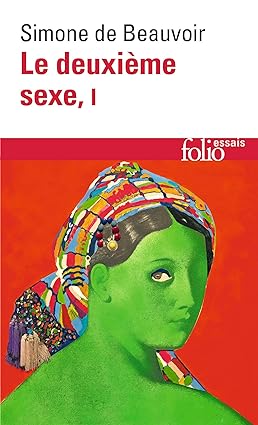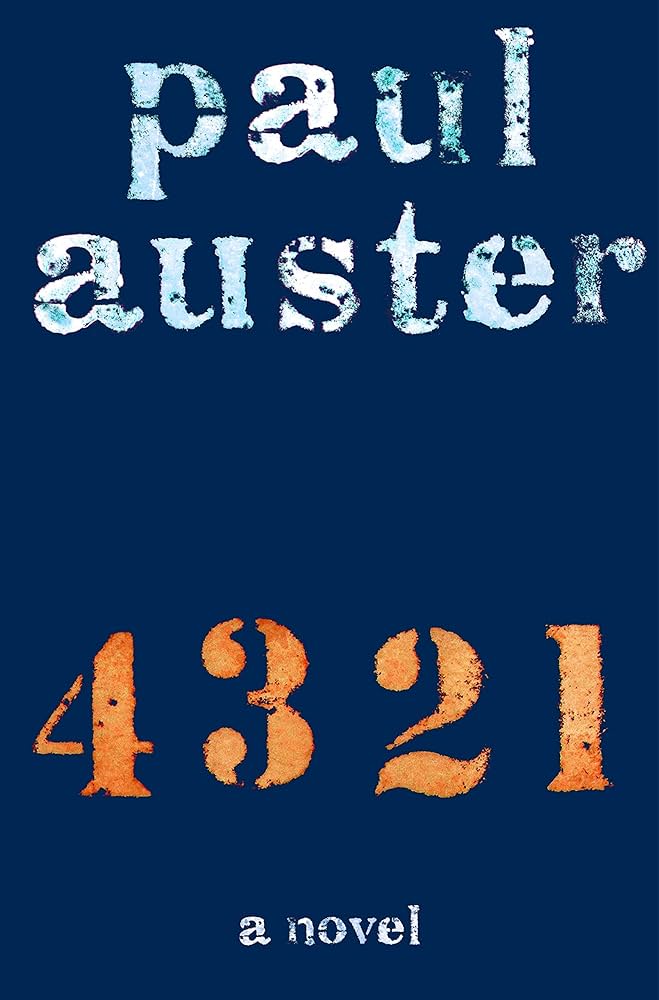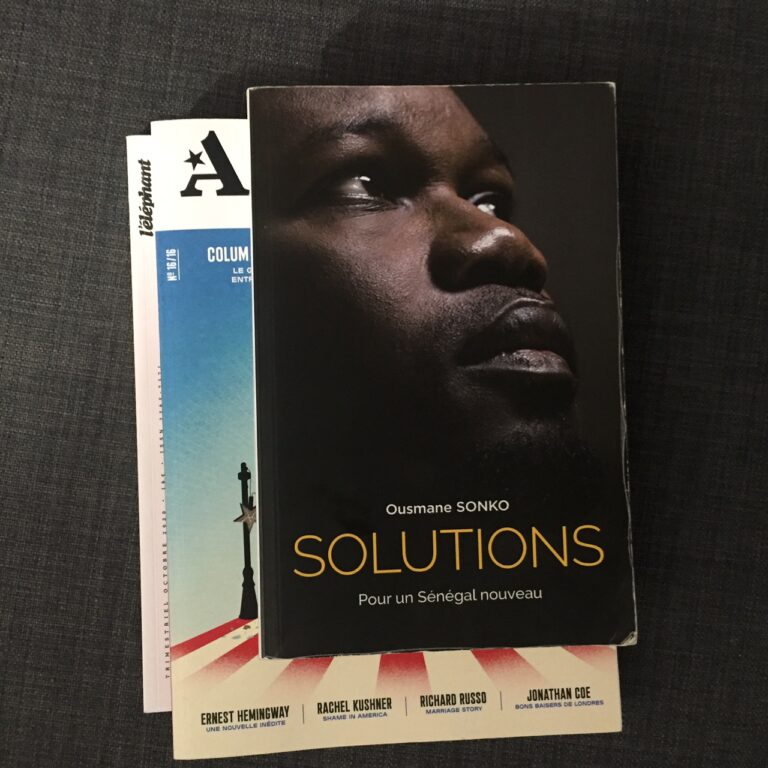Un événement tragique secoue depuis quelques jours le paysage politique américain : un militant actif de la droite conservatrice a été éliminé par un militant se réclamant de la gauche, woke. Ce drame n’est pas seulement une affaire de violence individuelle, il dit quelque chose de plus profond : la fragilité de la démocratie quand l’idéologie s’arme et que la parole cède le pas à la brutalité.
La droite américaine voit dans ce geste la preuve que ses mises en garde étaient justifiées. Depuis des années, elle dénonce une gauche radicalisée, intolérante, prompte à disqualifier moralement, puis à ostraciser, quiconque ne partage pas ses convictions. Cet assassinat semble donner corps à cette accusation : si la critique d’un discours ne suffit plus, si l’on en vient à détruire la personne qui le porte, alors oui, la liberté d’expression est directement menacée.
Mais il faut prendre garde au piège des généralisations. Ce crime n’invalide pas la gauche dans son ensemble, pas plus que des tueries commises par des extrémistes de droite ne condamnent toute la droite. L’idéologie, lorsqu’elle se rigidifie au point de devenir une religion séculière, peut conduire certains de ses adeptes à basculer dans la violence. L’acte d’un seul révèle un danger, mais il ne saurait effacer la pluralité des sensibilités.
Ce qui demeure certain, c’est que la démocratie repose sur un pacte fragile : celui d’accepter l’existence d’idées que l’on combat. La confrontation intellectuelle, aussi vive soit-elle, doit toujours se résoudre dans l’argument et jamais dans le passage à l’acte. Qu’un militant progressiste en vienne à tuer un conservateur, c’est non seulement un crime contre un individu, mais un double crime contre le principe même de liberté qu’il prétend défendre.
Il faut aussi constater le risque symétrique : la droite, en érigeant ce drame en symbole, pourra être tentée de construire un récit victimaire global. Cette instrumentalisation peut nourrir à son tour la polarisation et justifier d’autres violences. L’horreur d’un crime ne doit pas devenir l’alibi d’une escalade idéologique.
La liberté d’expression n’est pas un luxe, c’est l’oxygène des sociétés libres. Chaque fois que l’on tue au nom d’une idée, on étrangle cet oxygène. Ce qui menace aujourd’hui les démocraties n’est pas seulement l’existence de camps opposés, mais la conviction croissante, à droite comme à gauche, que l’adversaire n’est plus un interlocuteur mais un ennemi. C’est là le vrai danger, et c’est là qu’il faut réagir.
Dans quelques heures, environ 200 000 personnes inscrites se rendront au State Farm dans la banlieue de Phoenix (Arizona), pour rendre un dernier hommage à Charlie Kirk. influenceur ultra-conservateur tué par balle dans une université de l’Utah le 10 septembre.
Comme l’écrivait F. Scott Fitzgerald dans The Crack-Up :
« la marque d’une intelligence de premier plan est qu’elle est capable de se fixer sur deux idées contradictoires sans perdre la possibilité de fonctionner. C’est ainsi que l’on devrait pouvoir comprendre que les choses sont sans espoir, et cependant être décidé à les changer. »
C’est peut-être cette tension-là que la démocratie doit retrouver : voir lucidement la gravité de nos divisions, sans renoncer à l’effort de les dépasser.