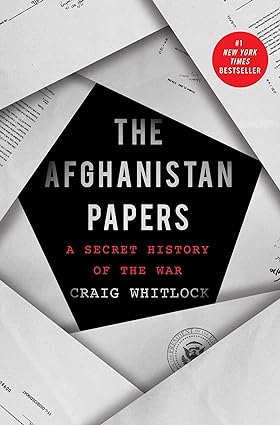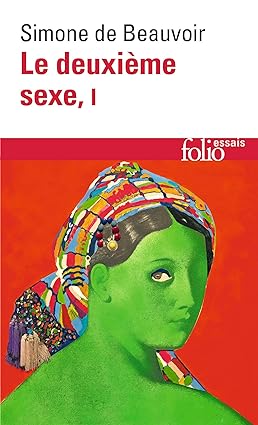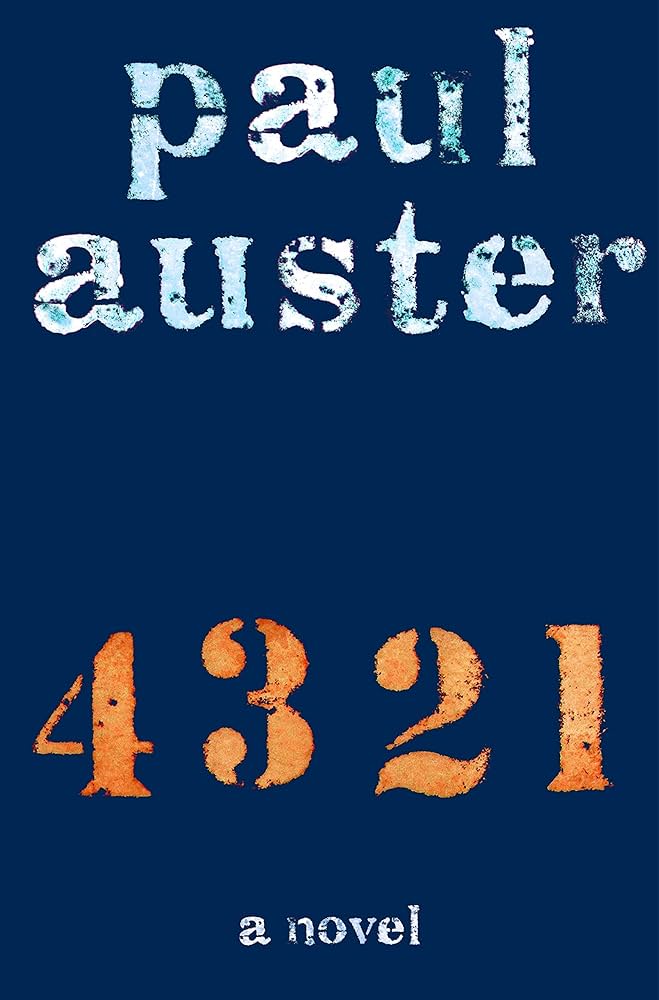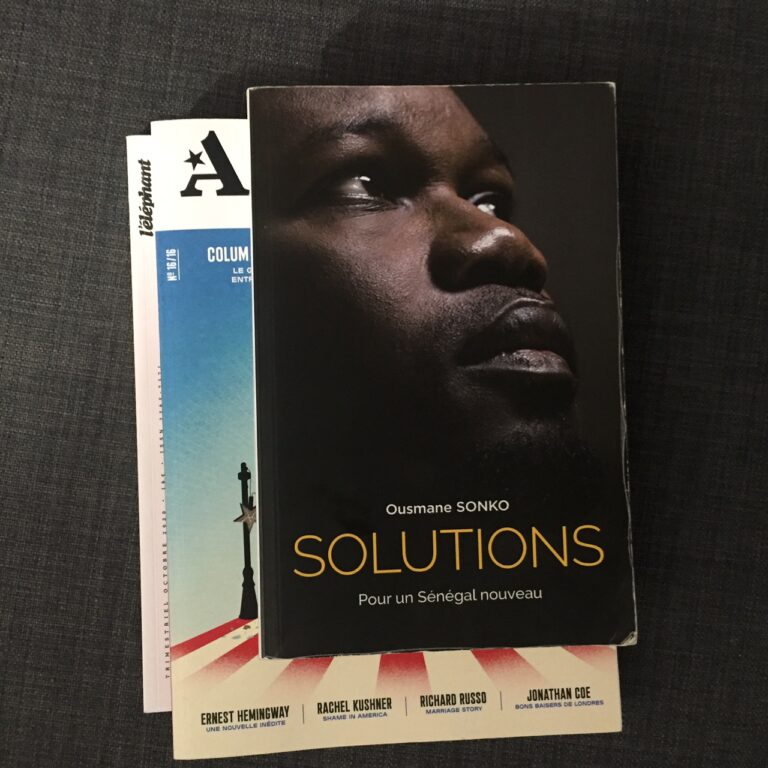Auteur de l’article : Julien Longhi, CY Cergy Paris Université
L’annonce de la mort de Robert Badinter s’est accompagnée de très nombreux hommages, dessinant le portrait d’une personnalité faisant aujourd’hui l’unanimité.
Parmi les multiples prises de position de ce grand homme d’État, défenseur infatigable des libertés publiques, son combat victorieux pour l’abolition de la peine de mort, mené en tant que garde des sceaux de François Mitterrand, restera sans doute comme le plus emblématique.
À ce titre, le discours qu’il a prononcé à l’Assemblée nationale, le 17 septembre 1981 dans le cadre de la discussion du projet de loi portant sur l’abolition de la peine de mort, a fait date. La loi sera adoptée le 18 septembre 1981, par 363 voix contre 117.
Extrait d’un journal télévisé d’époque sur le discours de Robert Badinter.
Ce discours est visible dans son intégralité sur le site de l’INA, et on peut le consulter ici.
Ce texte a fait l’objet de beaucoup d’attentions et de commentaires, dans le cadre politico-médiatique.
Pour ne pas réaliser une nouvelle analyse formelle de ce texte, et afin de porter également à la connaissance des lecteurs d’autres prises de parole de Robert Badinter, nous proposons une mise en relief de caractéristiques de ce discours en lien avec ce que lui-même disait de l’art oratoire, en particulier dans le cadre d’un podcast diffusé sur France culture. C’est dans le 5ᵉ épisode de cette série, diffusée pour la première fois en 2002, qu’il est question des mots prononcés par Robert Badiner pour en finir avec la peine de mort.
L’avocat y explique que « ça n’était pas une question d’argumentation » et que ce discours n’avait « pas le caractère d’une plaidoirie » : cela signifie que l’enjeu de sa prise de parole dépassait le simple fait de réussir à convaincre, mais qu’il fallait qu’elle soit à la hauteur de l’événement, et de la transformation qu’elle allait entraîner dans la société française.
Il est ici très intéressant, pour un analyste du discours, d’écouter les mots de l’orateur à propos de l’éloquence. S’il considère notamment « la parole comme outil », s’il estime qu’il n’y a « pas de grands avocats, mais de grandes causes », il livre néanmoins en creux une définition du discours et de ses pratiques.
Émotions et raison : une argumentation millimétrée
Dans ses analyses de l’art oratoire, Robert Badinter estime qu’« une émotion ressentie ne peut être communiquée que si l’expression en est toujours en deçà plutôt qu’au-delà ». Cela nécessite une maîtrise fine de l’écriture du discours, en particulier en ce qui concerne la dimension pathétique.
Selon le linguiste Marc Bonhomme, le terme de pathos
« désigne les effets émotionnels et passionnels produits par un discours sur le public. Il comporte à la fois une dimension sociodiscursive (émotion partagée par plusieurs individus), interactive (émotion communiquée entre énonciateur[s] et énonciataire[s]) et dynamique (émotion construite au moyen du langage) ».
Lorsque l’on considère le discours pour l’abolition de la peine de mort, on peut considérer que le sujet se prête à un partage d’émotion par une large audience, au-delà de l’Hémicycle. À travers le choix de certains extraits, nous allons nous attarder sur la dimension pathétique de cette allocution, c’est-à-dire sur l’émotion créée par la combinaison des trois dimensions décrites précédemment. Leur combinaison habile permet à l’orateur de parler au groupe et aux individus dans un même mouvement.
« La mort et la souffrance des victimes, ce terrible malheur, exigeraient comme contrepartie nécessaire, impérative, une autre mort et une autre souffrance. À défaut, déclarait un ministre de la justice récent, l’angoisse et la passion suscitées dans la société par le crime ne seraient pas apaisées. Cela s’appelle, je crois, un sacrifice expiatoire.
[…] Malheur de la victime elle-même et, au-delà, malheur de ses parents et de ses proches. Malheur aussi des parents du criminel. Malheur enfin, bien souvent, de l’assassin. Oui, le crime est malheur, et il n’y a pas un homme, pas une femme de cœur, de raison, de responsabilité, qui ne souhaite d’abord le combattre. Mais ressentir, au profond de soi-même, le malheur et la douleur des victimes, mais lutter de toutes les manières pour que la violence et le crime reculent dans notre société, cette sensibilité et ce combat ne sauraient impliquer la nécessaire mise à mort du coupable. Que les parents et les proches de la victime souhaitent cette mort, par réaction naturelle de l’être humain blessé, je le comprends, je le conçois. Mais c’est une réaction humaine, naturelle. Or tout le progrès historique de la justice a été de dépasser la vengeance privée. Et comment la dépasser, sinon d’abord en refusant la loi du talion ? »
Ici, les termes comme souffrance, malheur, angoisse, passion, ou sensibilité, qui sont répétés voire martelés, délivrent un effet émotionnel portant l’auditeur à engager sa sensibilité, et à réagir non seulement avec sa raison, mais aussi avec son cœur.
On peut relever que ce terme est utilisé sept fois au cours de la prise de parole, dans laquelle il salue d’ailleurs la capacité de Jean Jaurès à allier « l’éloquence du cœur et l’éloquence de la raison ».
Concernant l’appel au groupe, le recours au « progrès historique de la justice » par exemple, ancre le propos dans un contexte historique plus large que le ressenti des émotions.
Ce qui est intéressant, c’est que cette émotion est mise au service d’un procédé rhétorique que le linguiste Raphaël Michelli a mis en évidence dans ses analyses des débats abolitionnistes.
Celui-ci relève une analogie, dénoncée par Badinter, que l’on peut formuler comme suit : la sanction du crime que prononce la justice est à la société ce que la vengeance privée est à « l’être frappé dans sa sensibilité ». Le garde des sceaux s’attache à rendre cette analogie inacceptable. Il montre qu’on ne peut considérer la justice comme recouvrant les caractéristiques de la vengeance, ni mettre sur le même plan la société et la victime : la société dans son ensemble ne doit pas raisonner comme un seul être meurtri.
On trouve ici un écho à une autre formule de Robert Badinter, qui insiste sur la « nécessité que celui qui vous écoute ne soit jamais étranger à ce que vous dîtes ». Le procédé de l’analogie contribue pleinement à construire ce lien.
Pour cela, Robert Badinter mobilise le pathos, joue sur les émotions, mais il procède aussi d’une rhétorique rigoureuse pour donner de la consistance à son argumentation, tout en gardant une proximité avec son auditoire. Cela s’intègre à une seconde dimension, la dimension relationnelle et interactive du discours.
L’éloquence est « toujours une relation, jamais un discours »
Pour Badinter, l’éloquence, qu’il entend comme étant l’art de séduire et de convaincre, est « toujours une relation, jamais un discours ». Il explique en effet que le discours est unilatéral, alors que c’est la prise en compte constante de ce que l’autre ressent qui importe.
Pour préciser ce dont il est question ici, rappelons que dans la triade éthos/logos/pathos proposée par Aristote pour expliquer l’art de la rhétorique, ethos et pathos permettent de persuader, le logos (discours rationnel), de convaincre.
Pour convaincre, donc, Robert Badinter s’appuie bien également sur le logos, dans lequel il s’agit de faire « le choix d’arguments appropriés à la situation ».
Il est donc question de l’adaptation à son public, et de l’anticipation sur ce qui pourra le convaincre. Pour cela, l’orateur prend explicitement en compte les avis opposés aux siens, pour les discuter et les nuancer, non pas de manière frontale, mais avec une beaucoup de finesse et diplomatie :
« Il s’agit bien, en définitive, dans l’abolition, d’un choix fondamental, d’une certaine conception de l’homme et de la justice. Ceux qui veulent une justice qui tue, ceux-là sont animés par une double conviction : qu’il existe des hommes totalement coupables, c’est-à-dire des hommes totalement responsables de leurs actes, et qu’il peut y avoir une justice sûre de son infaillibilité au point de dire que celui-là peut vivre et que celui-là doit mourir. »
Rappelons que l’homme a manifesté un engagement de longue date, en tant qu’avocat, sur la question de la peine de mort : sa défense de Roger Bontems, puis de Patrick Henry, ont en effet façonné son combat. Et, comme il l’a raconté par la suite et comme on le ressent dans son discours, l’exécution de Roger Bontems, à laquelle il assista en 1972, le marque à jamais.
La réfutation se fait à la fois par la démonstration logique, mais elle est introduite par une touche personnelle appuyant sur l’expérience de l’orateur :
« À cet âge de ma vie, l’une et l’autre affirmations me paraissent également erronées. Aussi terribles, aussi odieux que soient leurs actes, il n’est point d’hommes en cette terre dont la culpabilité soit totale et dont il faille pour toujours désespérer totalement. Aussi prudente que soit la justice, aussi mesurés et angoissés que soient les femmes et les hommes qui jugent, la justice demeure humaine, donc faillible. »
Cette dimension faillible peut prendre la forme de « l’erreur judiciaire absolue, quand, après une exécution, il se révèle, comme cela peut encore arriver, que le condamné à mort était innocent ». Mais elle peut aussi se traduire par « l’incertitude » et « la contradiction des décisions rendues » : différentes cours ou magistrats peuvent rendre des verdicts différents pour des mêmes faits et affaires.
On voit bien ici, à la suite de Raphël Michelli, que
« dans son argumentation, il [Robert Badinter] cherche à débarrasser l’orateur abolitionniste d’un éthos humaniste naïf, aveuglé par sa foi en l’homme ».
Il se crédite en effet d’un éthos de logique et d’évidence, qui assoit l’argumentation, et anticipe sur les discours antagonistes et les objections.
Un monologue en forme de dialogue : un orateur interlocuteur
On peut ainsi dire que Robert Badinter réussit son pari en « coupant l’herbe sous le pied » de ses contradicteurs.
« La vérité est que, au plus profond des motivations de l’attachement à la peine de mort, on trouve, inavouée le plus souvent, la tentation de l’élimination. Ce qui paraît insupportable à beaucoup, c’est moins la vie du criminel emprisonné que la peur qu’il récidive un jour. Et ils pensent que la seule garantie, à cet égard, est que le criminel soit mis à mort par précaution. Ainsi, dans cette conception, la justice tuerait moins par vengeance que par prudence.
Au-delà de la justice d’expiation, apparaît donc la justice d’élimination, derrière la balance, la guillotine. L’assassin doit mourir tout simplement parce que, ainsi, il ne récidivera pas. Et tout paraît si simple, et tout paraît si juste ! Mais quand on accepte ou quand on prône la justice d’élimination, au nom de la justice, il faut bien savoir dans quelle voie on s’engage. Pour être acceptable, même pour ses partisans, la justice qui tue le criminel doit tuer en connaissance de cause. […]
Je m’en tiens à la justice des pays qui vivent en démocratie. Enfoui, terré, au cœur même de la justice d’élimination, veille le racisme secret. […] Depuis 1965, parmi les neuf condamnés à mort exécutés, on compte quatre étrangers, dont trois Maghrébins. Leurs crimes étaient-ils plus odieux que les autres ou bien paraissaient-ils plus graves parce que leurs auteurs, à cet instant, faisaient secrètement horreur ? C’est une interrogation, ce n’est qu’une interrogation, mais elle est si pressante et si lancinante que seule l’abolition peut mettre fin à une interrogation qui nous interpelle avec tant de cruauté. »
Le passage commence par entrer en dialogue avec les tenants de l’« attachement à la peine de mort », cette « conception », ses « partisans ».
Il argumente en lien avec la vengeance, la prudence, et l’élimination, mais surtout il parvient à réorienter la discussion vers « une interrogation qui nous interpelle » : cette formulation ne pourrait pas être davantage orientée vers le dialogue, et pourtant elle procède d’une habileté à faire le lien entre élimination et racisme, et donc à mettre en cause les jugements moraux au regard de l’origine des condamnés.
On retrouve bien ce que le sociologue Francis Chatauraynaud appelle la « reprise dialogique des arguments adverses ».
Ici, Robert Badinder met en lien des arguments et des valeurs, et fait le lien entre l’abolition et des valeurs de gauche : il met en discussion les doctrines, les arguments, et positionne son argumentation de manière juste et efficace.
Conclusion : les mots ont un sens, qui se partage, dans une certaine mesure.
Si Robert Badinter en réfère à la fois au cœur et à la raison des députés, c’est qu’il s’est livré, dans son discours, à une argumentation pleine et totale : captivant l’auditoire par les émotions, il a mis ce recours aux affects au service d’une logique implacable et d’une démonstration précise, qui entre en dialogue avec les objections et réfutations potentielles.
Cette relation crée donc un partage du sens, une co-construction d’une réalité qui allie ses arguments et les discours circulants.
« Faussaires de l’Histoire »
Reste qu’il y a une limite à cette plasticité du discours et des mots, qu’il a magnifiquement résumée lors d’une séquence face à Robert Faurisson devant la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, en mars 2007. Robert Badinter s’adresse alors à l’historien négationniste, qui le poursuit en diffamation, pour l’avoir qualifié, lors d’une émission diffusée sur la chaîne Arte, de« faussaire de l’histoire ».
Le 12 mars 2017, au Tribunal de grande instance de Paris, Robert Badinter se défend face au négationniste Robert Faurisson.
Il est question dans cet extrait de l’expression « escroquerie politico-financière » que Faurisson utilise à propos des demandes de réparation financières des juifs survivants de déportation ou des descendants des victimes de l’Holocauste.
Voici les mots de Robert Badinter, qui gagnera ce procès :
« Les mots ont un sens, sauf pour ceux qui les utilisent comme vous. Et pour qu’il n’y ait aucune équivoque, que les choses soient claires, pour moi jusqu’à la fin de mes jours, tant que j’aurai un souffle, Monsieur Faurisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l’Histoire. »
On ressent bien ici cette dimension incarnée, et partagée, des mots et de leur sens, et de leur dimension relationnelle : cette relation, possible dans le cadre de son fameux discours pour réclamer l’abolition de la peine de mort, est ici rendue impossible, tant la distance et l’opposition avec l’interlocuteur est totale et irréconciliable.
Cela remet en quelque sorte l’humain au cœur de la langue, interroge sur son partage, et illustre la nécessité de ne pas transiger en matière de discours. Les mots ne sont pas que des mots.
Julien Longhi, Professeur des universités en sciences du langage, AGORA/IDHN, CY Cergy Paris Université
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.